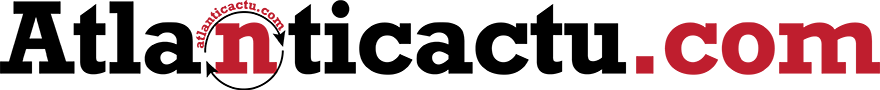Je me suis permis de changer de genre rédactionnel pour t’inviter à un débat sur la vie, la compassion, la peur de la mort, l’éloge de la vie, ta vie
Tu sais, ce dimanche matin, c’était les derniers adieux avec toi. A la morgue de l’hôpital Principal où, Alcaly, ton fils confia que te fus hospitalisé pendant trois mois. A cette occasion, il a rendu un hommage poignant « au corps médical, national et étranger, d’éminents médecins, professeurs, infirmier.e.s » qui ont veillé sur toi ; qui ont peut être aussi, allongé ta vie de quelques années.
Tu me connais, comme toi, je peux avoir l’esprit mal tourné, faire des remarques qui cisaillent la vérité : tout compte fait, on n’est pas, obligatoirement, obligé d’aller à l’étranger pour se soigner. Il s’agit simplement d’investir dans nos structures sanitaires, les équiper, mettre à l’aise nos corps médicaux. Je sais bien qu’il y a la coopération médicale, des plateaux médicaux inégaux et différends dans la qualité, des spécialités et spécialistes multiples, mais, de là à faire des hôpitaux de l’occident nos passages obligés aux soins de qualité, c’est qu’il y a quelque chose de pourrie dans notre système sanitaire. Ton fils a montré qu’il fallait faire confiance à notre corps médical ; qu’il était bon, mais démuni. Je suis sûr que tu es d’accord avec cette analyse.
La maladie, les soins, la vie, la mort, c’est notre lot d’humains, notre destin inévitable. Qui m’amène aux levées du corps, à la « levée du corps ». On ne lève pas le corps, on le prépare à sa dernière demeure, on l’enferme dans la caisse en bois (cercueil) qui lui fait office de demeure.
La double porte de la salle (chambre ?) mortuaire s’ouvre sur …cette caisse en bois enrobée du drapeau national, portée par quatre gaillards militaires ; on le pose sur ces deux tréteaux sur lesquels il est écrit « zone militaire 1 ». Je tourne le regard, je ne veux pas voir ça, je veux observer tous ces visages alentours, graves, sérieux, inquiets, angoissés. Et je me dis : ils regardent qui, ils pensent quoi ? A quoi ? Et là, j’ai une lumière : ce n’est pas de ta mort, de ta disparition dont ils ont pitié, peur ; non, c’est cette place qu’ils occuperont demain, cette cage en bois sur des tréteaux, avec le drapeau national si tu es une autorité, ou une simple toile.
Ces visages graves, ces murmures en aparté, ces éclats de voix forcés, ces sonneries de téléphone qu’on étouffe, c’est eux, c’est nous, demain. Et ça nous fout la pétoche. Il ne faut pas croire au fatalisme rassurant qu’on assène à ces occasions : on y passera tous un jour. Mais on murmure aussitôt « le plus tard possible ». La compassion pour les morts, c’est d’abord la nôtre, l’inéluctabilité de notre finitude. Notre présence à ces cérémonies de « départ sans retour », c’est pour conjurer notre mort, dire à la mort qu’on n’est pas pressé de suivre le parent, l’ami, le camarade qu’elle vient de nous prendre. Ç’aurait pu être un sacré sujet de discussion entre toi et moi…
On découvre toujours de ses hôtes, des secrets sur ceux et celles qui nous quittent. Comme par exemple, cette grosse révélation de ton fils, Alcaly, sur tes qualités culinaires. Et les moqueries espiègles que tu lançais avec finesse, à l’endroit de l’un de tes enfants qui rataient son plat, sa recette. Dis, tu as appris la cuisine où ? À Saint-Louis quand tu étais élève ou lycéen ? Dans le glacis des pays de l’Est ou tu séjournas longtemps ? En tout cas, ton fils se pâme presque sur tes qualités de Maître cuissot.
Et puis, cette anecdote, non, cette information sur ta première rencontre dans les années 80 avec le premier cas de sida, à l’hôpital de Fann (?), que ta moitié, Elisabeth, (Babette pour les intimes) te présenta. Humain, peut être trop humain, tu enlaças le malade comme si c‘était la maladie la plus courante. A l’époque, l’ignorance de cette nouvelle maladie, alimentait les légendes urbaines. On pensait que même serrer la main à ces malades vous ferait attraper leur maladie. Et tu le serras dans tes bras. Trop rationnel, trop confiant à l’humain et à l’Humanité. C’est toi ça.
Voilà, je me suis permis de changer de « genre rédactionnel », comme on dit dans notre jargon professionnel (ignorer le compte rendu traditionnel) pour mixer plusieurs genres et t’inviter à un débat sur la vie, la mort, la compassion, la peur de la mort, l’éloge de la vie, des vies. La tienne.
Certaines bonnes âmes, sans doute de bonne foi, trouveront sans doute ce style, ce genre rédactionnel, cette légèreté en ce moment solennel, d’une abomination sans nom, mais j’assume le choix de mes mots. Avec la prétention de croire que loin de t’offusquer, tu aurais approuvé, ou tout au moins, tu en aurais interrogé la pertinence.
Ah, juste deux dernières confidences : le lendemain soir de ta disparition, ton ami et faux jumeaux, Alpha Condé m’a dit au téléphone : « c’est grave Demba, en moins d’une semaine je perds deux de mes meilleurs amis, Jacques Diouf et Amath ». Je garde le silence, rien sur la ligne et puis il revient et me dit : « avec Amath, c’est le dernier des mohicans qui s’en va ». Je lui dis en riant : « il reste encore un mohican. C’est toi ». Cette génération de panafricanistes, qui qui voyaient l’Afrique et non les mesquines petites frontières que le colon nous a laissées. Qui pensaient disposer d’une arme fatale pour libérer le continent ; la FEANF, la Fédération des étudions d’Afrique noire en France.
Oui, il en reste peu, très peu de cette race … d’anciens combattants. Amath vient encore de la dégarnir davantage.
A 14h45, tu ne dois plus être loin de ta ville d’adoption, Saint-Louis. Qui fut aussi celle de mes études secondaires. Au Lycée Charles De Gaulle…
Je te laisse à tes retrouvailles éternelles avec la vieille ville. Tes amours d’enfance, et ton école de vie, de la politique.
Reposes-toi enfin, dans ta dernière demeure. Entre fleuve et mer.
dndiaye@seneplus.com